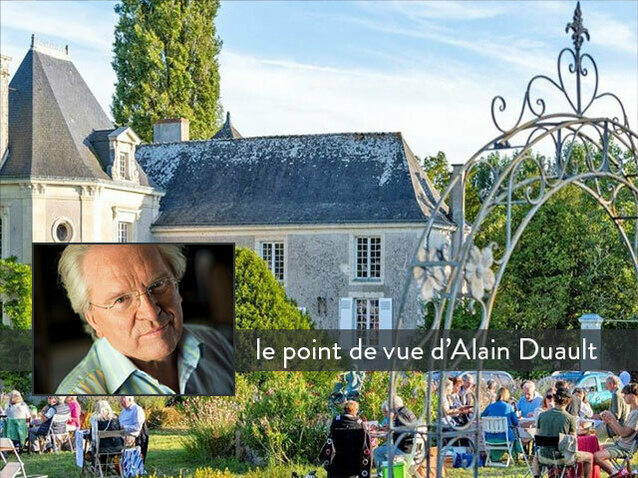 © Festival d'Opéra de Baugé 2025
© Festival d'Opéra de Baugé 2025
Pour sa 21e édition le Festival de Baugé, créé en 2003 par ce formidable couple d’anglais, Bernadette et John Grimmett, qui sont parvenus à inscrire ce « Glyndebourne angevin » dans le paysage des rendez-vous lyriques de l’été, n’hésite pas à voir haut – en programmant (entre autres !) deux opéras parmi les plus importants du répertoire, Don Giovanni de Mozart et Le Chevalier à la rose de Richard Strauss !
Quand on a subi l’inanité du même (?) Don Giovanni au Festival d’Aix-en-Provence deux semaines plus tôt (avec des moyens dix à vingt fois plus importants), il est rafraichissant d’entendre et voir le chef-d’œuvre de Mozart proposé ainsi que le souhaitait Mozart, non pas platement à la lettre mais dans le respect intelligent des intentions du compositeur, mi dramma mi giocoso, avec ce qu’il faut de légèreté et ce qu’il faut de métaphysique (cette métaphysique que concentre le Commandeur du toujours parfait Denis Sedov, voix venue tout à la fois du ciel et de la terre, dans une scène finale particulièrement réussie). Car, outre sa probité théâtrale, la réussite du spectacle est assise sur une juste réalisation musicale, avec un orchestre Mozart d’une quarantaine de musiciens tous excellents placés sous la baguette fine et souple du jeune anglais Thomas Payne, avec surtout une distribution très équilibrée, le Don Giovanni à la voix bien timbrée et projetée de l’Ukrainien Yuriy Yurchuk, une Anna subtile à laquelle la voix de Belinda Williams apporte une émotion palpable et encore une Elvira accomplie, autant par un timbre aux riches couleurs que par une présence dramatique puissante, Aleksandra Kovalevich. Sans oublier un Ottavio qui n’a plus rien du personnage un peu falot qu’on nous sert trop souvent : là c’est un véritable amoureux qui sait se faire entendre, d’autant que la voix du ténor argentin Pablo Bemsch s’impose avec un naturel évident.

Mais c’est bien évidemment Le Chevalier à la rose qui constituait le pari audacieux de cette édition car, quand nombre de grandes maisons hésitent à programmer le chef-d’œuvre de Strauss, les Grimmett, eux, ont osé avec ce naturel des véritables amoureux de l’opéra ! Et ils ont réussi leur pari un peu fou. Non que tout soit totalement accompli dans cette réalisation mais le résultat s’est hissé à la hauteur de l’enjeu.
Sur le plan scénique, Bernadette Grimmet nous entraine avec le premier acte dans un véritable palais viennois, celui de la Maréchale. On la découvre dans un lit avec son jeune amant, à l’issue de cette nuit qui a été manifestement le théâtre d’un déferlement de sensualité – ce que la musique de l’introduction figure, avec l’appel de ces cors à la sonorité outrageusement charnelle et la réponse féminine aux violons : toute cette ouverture est la description évidente d’une nuit d’amour ardente, mais c’est aussi là que nait le thème d’amour qui sera le fil conducteur de tout l’ouvrage, jusqu’à son apothéose au 3e acte. La réussite est patente, portée d’emblée par le rôle-titre, ce jeune Octavian qui, encore étourdi de cette nuit, s’exclame « Wie du warts ! Wie du bist ! (Comme tu as été ! Comme tu es !), ajoutant innocemment « Das weiss niemand, das ahnt keiner ! (Nul ne te sait ainsi, nul ne t’imagine ainsi !). Il a tout, cet Octavian, il est jeune, beau, vrai, il est doué d’une présence scénique qui s’impose d’un seul geste, il sait passer avec naturel de l’un à l’autre des deux travestissements de son personnage, et son timbre de mezzo clair est fruité sans lourdeur, ses phrasés simples et justes, sa musicalité parfaite : il/elle s’appelle Hedvig Stenstedt, retenez ce nom !
Autour de lui, tout un aéropage de voix multiples et d’incarnations diverses : la Maréchale de la soprano portugaise Susana Gaspar est bien chantante mais elle n’habite pas vraiment son personnage, manquant de ce mélange de nostalgie et de mélancolie qui tisse l’âme de cette femme qui voit venir trop vite cet avenir qu’elle pressentait. Manquant de cette fêlure qui doit faire entendre son subtil (mais aristocratique) désarroi, elle chante bien tout ce qui est écrit mais elle ne le parle pas, elle ne l’exprime pas. L’autre femme du trio, Sophie, offre à Karlene Moreno-Hayworth l’occasion de faire entendre un joli timbre argenté, un peu flûté, mais sans le frémissement qu’on attend d’une Sophie, sans cet éveil à l’amour et à la sensualité qu’Octavian devrait provoquer en elle : une bonne chanteuse assurément mais un personnage plus esquissé que joué. Pourtant, il y a, à côté et face à l’Octavian, un interprète qui, à l’instar d’Hedvig Stenstedt, a tout pour lui, c’est le Baron Ochs de l’Ukrainien Volodymyr Morozov. D’abord, ce n’est pas un barbon mais bien un jeune noceur (qui aurait pu être un Don Giovanni tant on le sent excité par toute « odor di femmine ») et cette jeunesse d’attitude offre un juste contraste avec sa voix de basse fort bien timbrée, comme s’il y ajoutait ces épices qui donnent son épaisseur au personnage : il sait faire entendre ses désirs mais aussi ces restes de bonne éducation, cette familiarité avec n’importe qui mais aussi cette connivence avec la Maréchale, dont il sera bien évidemment toujours plus proche que du parvenu Faninal, grenouille bourgeoise qui veut se faire aussi grosse que le bœuf aristocrate… L’ensemble de la distribution rend fort bien hommage à la sublime musique de Richard Strauss, parfaitement dynamisée par le jeune chef grec Konstantinos Diminakis (auteur par ailleurs de la réduction de l’orchestre straussien, d’une centaine d’instruments aux quarante de l’Orchestre de l’Opéra de Baugé). Mais si les deux premiers actes sont impeccables, la première partie du troisième pèche un peu, aussi bien dans la pantomime que dans le tête-à-tête entre Ochs et Mariandel (la soi-disant domestique en fait Octavian travesti), du double fait d’un certain morcellement orchestral qui ôte sa fluidité à la musique, et d’un manque de dynamique scénique, sans humour, sans effets, comme si rien n’embrayait. Heureusement, tout revient au Finale avec d’abord un Trio qui laisse s’exprimer à la fois l’absolue beauté de la musique et les blessures de l’expérience : la Maréchale apprend le renoncement alors qu’elle demeure amoureuse, Octavian apprend la douleur du choix alors qu’il demeure attiré par le corps parfumé de la Maréchale mais qu’il sait que ce joyau pur que lui offre Sophie est aussi un cadeau du ciel, Sophie enfin apprend que la réalité n’est pas toujours de la couleur des rêves. Et tout cela se déploie comme un éventail sublime. Enfin il ne reste plus que ces deux jeunes gens qui vont devoir apprendre à vivre : leur duo est poignant de beauté pure, avec une juste économie de gestes. La vérité est dans la musique.
Pari quasiment réussi donc, salué avec force applaudissements par le public de l’Opéra de Baugé, cette institution entièrement privée qui, chaque été, grâce à ses donateurs et à sa nuée de bénévoles, offre ainsi des œuvres véritablement servies par des artistes, la plupart jeunes et pleins de sève qui ont un bel avenir devant eux, à l’instar d’Octavian et Sophie qui croient à l’amour – comme Bernadette et John Grimmett, totalement dévoués à cet art, l’opéra, qui est l’objet de leur amour en même temps qu’il en est le ciment. Ils ont su depuis vingt ans faire partager des œuvres de toutes sortes à un public venu de partout, qui découvre en même temps les beautés de l’Anjou et de cette charmante petite ville de Baugé – dont le nom résonne dorénavant comme un symbole d’excellence et de convivialité dans le monde des amateurs de cet art universel qu’est l’opéra.
Alain Duault
Baugé, août 2025
Don Giovanni au Festival de Baugé, les 29, 31 juillet et 3 août 2025
Le Chevalier à la Rose au Festival de Baugé, les 2, 5 et 7 août 2025

Commentaires